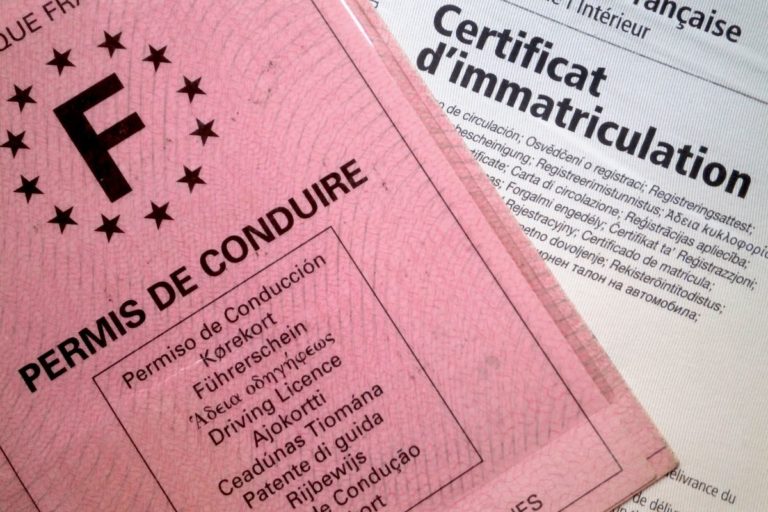
Voici comment avoir son permis de conduire directement sur son téléphone portable
Avec l’avancée rapide de la technologie et une volonté croissante de dématérialisation des services publics, la…
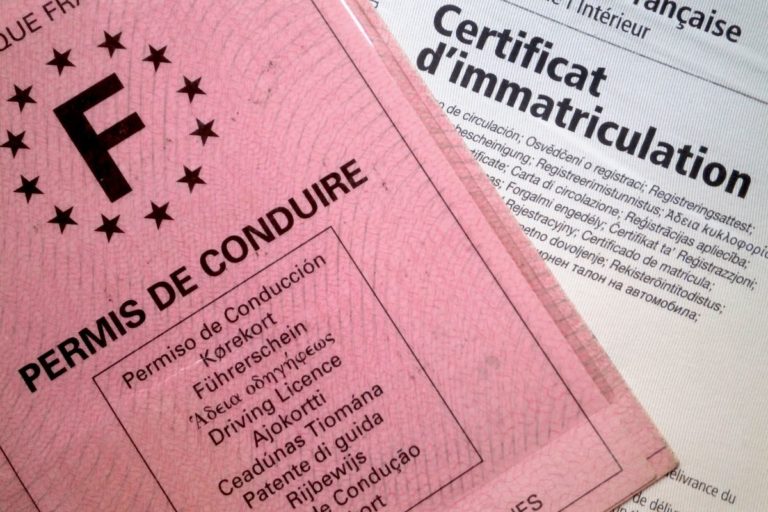
Avec l’avancée rapide de la technologie et une volonté croissante de dématérialisation des services publics, la…